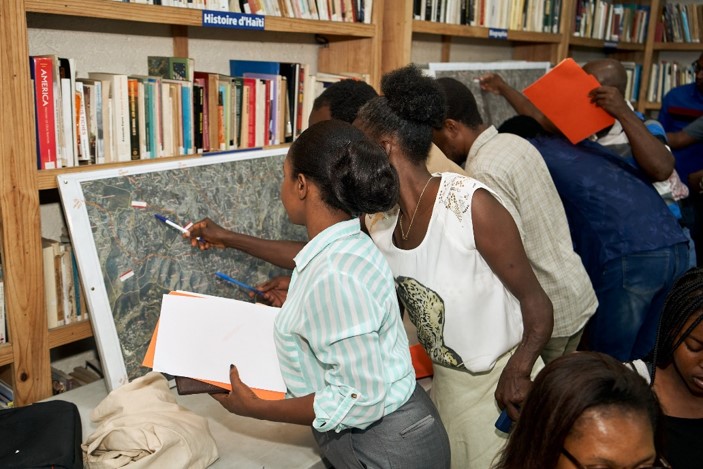Assises au bureau d’une de nos premières dames, nous étions venues discuter de la problématique des enfants de la rue. Elle voulait en faire son cheval de bataille. Je trouvais son choix judicieux, car il répondait à une urgence criante. Ce sujet me tenait profondément à cœur. Cela faisait des années que je tirais la sonnette d’alarme : si l’on ne fait rien, les enfants — nos enfants — se retourneront contre nous.
L’idée d’aborder enfin ce sujet avec une autorité haut placée, une femme de surcroît, m’avait redonné espoir. Conscientes de la complexité du sujet, nous avions soigneusement préparé la réunion, en abordant la délinquance juvénile sous plusieurs angles et en soulignant la nécessité d’un système de prévention solide : maisons d’accueil, éducation, réinsertion, justice juvénile, etc.
Mais à peine avions-nous entamé notre présentation que la première dame luttait contre le sommeil. Après deux ou trois coups de tête, elle s’est endormie. Par principe, nous avons continué jusqu’au bout des quarante minutes. Puis, la présentation terminée, nous ne l’avons plus jamais revue sur ce sujet — sauf dans les médias, distribuant kits alimentaires et cadeaux à des enfants sous l’œil des caméras. Le sujet était clos.
Nous avons compris que ce n’était pas notre présentation qui l’ennuyait. C’était le sujet lui-même. Ce qui l’intéressait n’était pas les enfants, mais la visibilité médiatique que l’événement pouvait offrir.
Cette absence de vision, cette indifférence envers notre jeunesse ne cessera jamais de me choquer.
Quarante-cinq pour cent de notre population a moins de 15 ans. Cela représente 5,4 millions de jeunes.
En 2005, dans un article intitulé « Qu’avons-nous fait de nos enfants ? », je posais déjà cette série de questions :
« Qu’avons-nous fait pour investir dans notre capital humain, pour le préserver et le consolider?
Qu’avons-nous fait pour rationnellement intégrer nos jeunes dans les divers secteurs de la vie nationale ?
Quelles activités sportives, culturelles ou sociales leur avons-nous offertes ?
Qu’avons-nous fait pour contrecarrer la délinquance juvénile ? »
Je concluais ainsi :
« Nous avons omis de respecter les droits fondamentaux de nos enfants.
Souvent, lorsqu’ils sont venus nous harceler dans les rues pour une aumône de quelques gourdes, nous les avons repoussés d’un geste qui ressemble fort à du mépris.
Aujourd’hui, ces mêmes enfants reviennent nous ôter le sommeil et faire un cauchemar de nos journées…
Aujourd’hui, ces mêmes enfants reviennent nous rappeler cyniquement que nous les avons délaissés…
La balance penche dangereusement d’un côté…
Rétablir un équilibre en redonnant à nos enfants une place dans l’avenir, tel est le défi que nous devons relever ensemble ! »
C’était il y a vingt ans…
Aujourd’hui, nous y sommes. En plein dedans.
Qu’avons-nous fait depuis ?
Peut-on encore parler, en toute conscience, d’éradication de ces jeunes sans tenir compte du problème dans toute sa profondeur ? Pensons-nous réellement qu’une simple opération de nettoyage réglera la question à long terme et de manière durable ?
Je ne parlerai pas ici des recruteurs, des chefs de gangs. Ils feront peut-être l’objet d’un autre article. Ici, je veux parler de nos enfants. Ceux qui vivent dans nos rues, aux pieds de nos business. Ceux qui sont la proie journalière de personnes mal intentionnées et sont transformés en machines à tuer. Que faisons-nous d’eux aujourd’hui ?
Une amie, militante des droits humains, me racontait une scène qu’elle a vécue à plusieurs reprises lors de ses visites dans une prison pour mineurs. Elle s’asseyait dans les cellules avec eux, sans dire grand-chose. Et alors, des enfants venaient simplement s’endormir dans ses bras.
Ils ne demandaient rien. Juste un peu de chaleur. De présence. D’humanité. Cette image me hante. Elle nous dit tout : ces enfants ont encore besoin d’amour. Ils ont encore soif d’affection. Ils ne sont pas tous irrécupérables. Certains le sont, oui, mais beaucoup d’autres peuvent encore être sauvés — si on leur tend la main à temps.
Le défi est immense. Car faire face à la délinquance juvénile ne se résume ni à quelques cadeaux distribués à Noël, ni à une politique d’éradication brutale.
Ce n’est pas une affaire de charité ponctuelle,
ni une logique de répression sans nuance.
C’est un travail de fond, qui demande une approche globale et humaine.
C’est à la fois un système de prévention, capable d’ouvrir des perspectives réelles aux jeunes:
des maisons d’accueil, de l’éducation de qualité, des activités sportives, artistiques, culturelles — autant de chemins pour redonner envie de vivre, de rêver, de construire.
Et c’est aussi une affaire de justice.
Mais PAS une justice centrée uniquement sur la faute et le châtiment.
Plutôt une justice réparatrice, qui cherche à comprendre, rééquilibrer, reconstruire le lien social. Une justice qui ne nie pas la faute, mais qui crée un espace pour prendre responsabilité, réparer, guérir.
Ce combat est un appel à retrouver notre humanité.
À raviver notre sensibilité collective.
À redonner à chaque jeune le droit d’avoir un avenir.
Le droit d’être aimé.
Le droit de grandir dans la dignité.
Nous avons tourné le dos à nos enfants.
Aujourd’hui, certains nous le rendent avec violence, d’autres avec silence.
Mais tous nous disent une seule chose : “Vous nous avez oubliés.”
Il est encore temps. Mais il faut choisir.
Choisir l’amour. Choisir la dignité humaine. Choisir de les regarder, enfin.
Ayiti leve pye’w !

Ce texte n’est pas un cri de colère, c’est un appel à la lucidité. Nous avons laissé tomber une génération entière. Le réveil est brutal, mais il n’est pas trop tard.